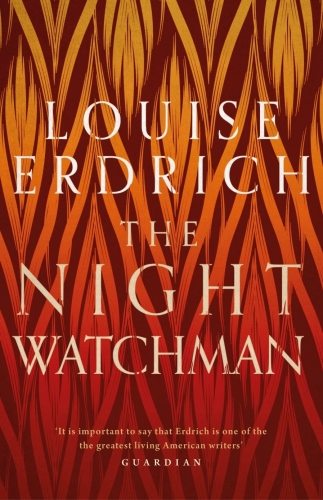Prix Pulitzer 2021, Celui qui veille (The Night Watchman, traduit de l’américain par Sarah Gurcel) m’a fait entrer dans l’univers de Louise Erdrich et de la Renaissance amérindienne. Née en 1954 d’une mère Ojibwa (famille des Chippewas) et d’un père germano-américain, Louise Erdrich s’est inspirée de la figure de son grand-père Patrick Gourneau, qui a combattu en tant que président du conseil tribal la Résolution 108 du Congrès des Etats-Unis d’Amérique visant à « abroger les traités de nation à nation qui avaient été conclus avec les tribus indiennes pour « aussi longtemps que l’herbe poussera et que l’eau des rivières coulera. » » Il travaillait comme veilleur de nuit (note de l’autrice).
Septembre 1953. Thomas Wazhashk est veilleur de nuit à l’usine de pierres d’horlogerie de Turtle Mountain (Dakota du Nord). Pixie ou Patrice, sa nièce imaginée par la romancière, y travaille avec d’autres ouvrières choisies pour leur habileté à coller « sur de minces tiges verticales des lamelles ultrafines de rubis, de saphir ou, moins précieux, de grenat, avant perforation » – un des premiers emplois industriels créés dans les environs de la réserve, des postes convoités (« un travail de Blanc »).
Thomas porte le nom du rat musqué, « wazhashk », modeste et travailleur – il y en a partout dans les marécages de la réserve. « Au commencement, après le Grand Déluge, c’était un rat musqué qui était parvenu à recréer la Terre. En ce sens, comme la suite le prouverait, Thomas avait reçu le nom parfait. » La nuit, il écrit d’une main ferme sa correspondance. Parfois, il sent une présence, voit un petit garçon accroupi dans l’usine: il n’est pas le seul à y voir de temps à autre un fantôme.
Pixie Paranteau ne veut pas qu’on l’appelle par ce prénom (Pixie, le lutin) et corrige à chaque fois : « Patrice ». Quand sa collègue Doris la raccompagne après le travail, elle descend de sa voiture au début du chemin pour ne pas que Doris voie « l’embrasure effondrée de l’entrée ni le fatras devant la maison » ni son père qui risque de sortir en titubant. Patrice et son frère y vivent avec leurs parents, ils sont pauvres. Sa sœur Vera, une fois mariée, est partie vivre à Minneapolis ; elle lui manque terriblement, comme à sa mère Zhaanat.
Cette « Indienne à l’ancienne » ne parle que le chippewa. Enfant, elle a été initiée aux cérémonies et aux récits fondateurs. Elle a transmis son savoir à Patrice, l’a envoyée à l’école où celle-ci a appris l’anglais et est « aussi devenue catholique ». Zhaanat fait venir son cousin Gerald qui a le pouvoir « de retrouver les gens » pour qu’il lui donne des nouvelles de Vera. Sa fille aînée ne lui a plus écrit depuis cinq mois. Pendant la cérémonie rituelle, « habité par un esprit particulier », Gerald « voit » Vera, allongée, immobile, « mais vivante », avec un bébé à côté d’elle.
« L’élève le plus brillant à qui Lloyd Barnes ait jamais enseigné les mathématiques pratiquait la boxe sous le nom de Wood Mountain. » Ces deux-là joueront un rôle important dans le récit. Le prof entraîne aussi le frère de Patrice ; tout le monde sait que Barnes est amoureux d’elle, sans s’être jamais déclaré. Mais Patrice se méfie des hommes, elle a échappé à une petite bande qui l’avait piégée près du lac en se jetant à l’eau. Par chance, son oncle Thomas y était sur son bateau de pêche et l’avait secourue. Elle demande quelques jours de congé à l’usine pour se rendre à Minneapolis et retrouver Vera.
Quand Thomas prend connaissance du texte du Congrès « censé émanciper les Indiens », sur proposition du sénateur Watkins, il comprend vite que la « termination » de la tutelle fédérale sur les terres indiennes cache une énième façon d’exterminer les tribus qui survivent misérablement. Au conseil tribal, tous sont conscients que cette résolution 108 viole les accords passés en les chassant de leurs terres. Ils décident de réagir en faisant signer une pétition et d’aller à Fargo voir le Bureau des affaires indiennes.
Le voyage de Patrice et son séjour à Minneapolis sur les traces de Vera seront encore plus compliqués qu’elle ne l’imaginait, surtout pour elle qui n’est jamais allée dans une aussi grande ville. Ce récit alterne avec ce qui se passe à Turtle Mountain où la résistance des Chippewas s’organise : un combat de boxe financera le voyage d’une délégation à Washington ; le Livre de Mormon laissé chez les Wazhashk par deux visiteurs zélés aide Thomas à comprendre la mentalité du sénateur Watkins ; une universitaire chippewa va les aider.
En même temps que se déroule cette double quête, familiale et politique, Celui qui veille relate le mode de vie des Amérindiens Chippewas au milieu du siècle dernier. La vie est loin d’être rose dans la réserve, mais le sens de la solidarité et le dévouement de leurs représentants jouent un grand rôle dans ce combat pour défendre les droits de leur communauté.
Le réalisme magique de Louise Erdrich s’exprime aussi bien dans la perception de la nature que dans les pratiques traditionnelles, certains de ses personnages sont particulièrement habités par l’esprit des ancêtres. Dans la postface, la romancière parle des lettres de son grand-père ; en les relisant, elle a pris conscience de l’importance du combat mené contre la « termination » qui fut un cauchemar pour de nombreuses tribus indiennes. Contre l’oubli, elle s’est mise à écrire Celui qui veille, encouragée par sa sœur Heid Erdrich, artiste et poétesse, avec laquelle elle a ouvert une librairie à Minneapolis en 2001.